- ANTICLÉRICALISME
- ANTICLÉRICALISMEOn se gardera de confondre l’anticléricalisme avec des notions voisines pareillement exprimées en termes négatifs. L’athéisme nie l’existence de Dieu, l’anticléricalisme suspend son jugement. Il peut tout aussi bien s’allier à une négation métaphysique (dans le cas du socialisme marxiste) ou aller de pair avec une profession de foi déiste. Il n’est pas davantage antichristianisme : au contraire, il a souvent prétendu – sincérité ou ruse de guerre – défendre le christianisme authentique contre les utilisations qui le défiguraient. Il n’implique pas irréligion : il entend seulement ramener l’influence de la religion, et singulièrement du clergé, dans les bornes qui doivent selon lui en délimiter le domaine. «Il faut choisir, disait Édouard Herriot en 1925, entre la religion d’État et la religion de l’apostolat. Quand la religion se bornera à ses moyens spirituels, quand elle ne sera plus cléricale, entre vous et nous, elle n’aura pas de protecteurs plus respectueux que nous.» L’anticléricalisme ne combat que le cléricalisme, se définit uniquement par opposition et par référence à lui. C’est une notion seconde, qui n’a pas d’existence propre; en rigueur de termes, si le cléricalisme n’existait point, il n’y aurait pas davantage d’anticléricalisme. Sa définition nous renvoie donc à celle du cléricalisme.Mais qu’est-ce que le cléricalisme? Sommairement, c’est la tentation, ou la tentative, pour les clercs, d’exercer sur la société civile une influence ou un pouvoir en vertu de leur ministère. Tantôt ils useront des armes spirituelles (censures ecclésiastiques, sacrements, prédications) pour régenter les esprits, les mœurs (ordre moral), le gouvernement; tantôt ils s’appuieront sur les gouvernants pour imposer leur religion. Dans l’un et l’autre cas, le cléricalisme signifie la confusion des ordres, l’ingérence de la société ecclésiale dans la société séculière et la dépendance du politique à l’égard du religieux. C’est contre cette confusion que s’insurge précisément l’anticléricalisme: il a pour fondement intellectuel ce postulat que les deux sociétés, civile et religieuse, sont distinctes, que les clercs ne doivent pas s’immiscer dans la direction des affaires publiques, que, peut-être même, le domaine religieux doit rester strictement privé.Il revendique en conséquence l’indépendance de l’État, la liberté de la conscience, le droit pour chacun de choisir sa croyance ou de n’en pas avoir. Sur ces grands principes, il rejoint la conception de la laïcité et s’accorde avec l’inspiration de l’individualisme libéral. Il apporte en propre une nuance polémique: c’est la forme combative de l’idéologie hostile à toute théocratie. Instruit par l’expérience historique, stimulé par la conviction que toute religion est vouée à se dégrader en cléricalisme, il monte une garde vigilante: prompt à dénoncer toute ingérence, il préconise des dispositions préventives contre la volonté de domination des clercs.L’anticléricalisme est donc dans une relation de réciprocité antagoniste avec le cléricalisme, effectif ou présumé. Non seulement il se définit par référence à lui, mais la courbe de son évolution historique est le reflet des espérances et des déconvenues du cléricalisme. L’expérience vérifie ainsi qu’il existe une relation d’interdépendance entre les deux phénomènes ou, plus exactement, de dépendance de l’anticléricalisme à l’égard du cléricalisme, l’inverse étant plus rare. Cette interaction affecte à la fois le volume et le contenu de l’anticléricalisme. Son intensité se règle sur la consistance et la force qu’il prête au danger clérical: toutes les recrudescences de passion anticléricale coïncident avec des retours en force du «parti clérical». L’anticléricalisme apparaît ainsi largement comme une réaction défensive. En sens inverse, s’il apparaît que la religion cherche à répudier ses prétentions cléricales, l’anticléricalisme s’apaise. Son histoire est ainsi spasmodique, faite de brusques flambées, suivies de rémissions plus ou moins prolongées.La solidarité de ces deux ennemis complémentaires se fait sentir aussi dans le contenu de l’anticléricalisme, dont la physionomie se modèle en partie sur le visage que lui présente la religion. Au XIXe siècle, on voit l’anticléricalisme évoluer en fonction des tendances ultramontaines qui caractérisent de plus en plus le catholicisme romain: face au resserrement de la discipline ecclésiastique, aux progrès de la centralisation romaine et à l’intransigeance dogmatique, l’anticléricalisme accentue son attachement à la liberté de pensée et aux droits de la raison, parce que, avec Littré, il voit le cléricalisme comme «l’esprit de l’Église catholique tendant à subordonner l’autorité temporelle à l’autorité ecclésiastique».Histoire de l’anticléricalismeÀ quand remontent ses origines? Le mot lui-même est relativement récent. Littré ne connaît que l’adjectif «anticlérical» et l’illustre par un exemple emprunté au Journal officiel du 27 juin 1876. Il semble apparaître en 1852 et son usage se répand à partir de 1859. Quant au mot «cléricalisme», son apparition ne semble guère plus ancienne: notre lexicologue le qualifiait de néologisme. Ici aussi l’épithète a été antérieure au substantif; mais l’adjectif «clérical» n’a longtemps eu d’autre signification que descriptive: il désignait ce qui se rapportait aux ecclésiastiques. C’est vers 1848 que le mot se charge d’une acception péjorative, qualifiant les entreprises illégitimes des clercs. Cette acception tend à prévaloir sous le second Empire. Le substantif serait venu de Belgique. L’apparition, quelques années plus tard, de leurs antonymes «anticlérical» et «anticléricalisme» confirme la relation de dépendance qui unit les deux notions.L’émergence, entre 1848 et 1876, de cette famille de vocables dans la langue politique illustre un moment décisif dans l’histoire de l’anticléricalisme. C’est une réaction de défense de l’esprit libéral et rationaliste contre les prétentions du pape à conserver sa souveraineté temporelle, contre les pressions des catholiques pour contraindre leur gouvernement à intervenir en faveur de Pie IX, contre le Syllabus , les dévotions nouvelles et les miracles. L’anticléricalisme prend alors le visage qu’il gardera durant plus d’un demi-siècle, au moins jusqu’à l’entre-deux-guerres.Si les mots ne surgissent qu’au milieu du XIXe siècle, l’anticléricalisme n’a pas attendu jusque-là pour se constituer. La nouveauté des années 1850-1875 concerne le contenu de l’idée; l’anticléricalisme se fonde désormais sur une pensée qui ne croit guère possible de dissocier religion et cléricalisme, et qui estime que l’affranchissement des esprits exige l’effacement des religions. Mais l’anticléricalisme remonte plus haut. Aussi loin qu’on explore le passé, il semble qu’on en trouve des traces et des manifestations. Au Moyen Âge même, la littérature des fabliaux en porte témoignage; quelques-uns des thèmes que l’anticléricalisme reprendra ensuite avec complaisance (le moine gourmand, paillard) viennent d’alors. Mais c’est un anticléricalisme bien différent de celui d’aujourd’hui: non seulement il n’est pas irréligieux, mais il accepte une société chrétienne toute pénétrée de l’influence de l’Église. Faut-il pour autant le rapprocher d’une variété originale de l’anticléricalisme contemporain, celui de l’intérieur, prompt à mettre les clercs en garde contre la tentation de déborder de leur ministère?La ressemblance avec l’anticléricalisme médiéval n’est qu’extérieure: actuellement, en effet, il se fonde moins sur des réactions d’humeur que sur une notion de la sécularisation de la société et de la distinction des ordres qui est, à tout prendre, plus proche de l’anticléricalisme de l’extérieur. Les deux anticléricalismes s’inscrivent ainsi dans une problématique commune que dominent les mêmes impératifs: liberté de la conscience, séparation de la croyance personnelle et des activités publiques, dissociation de l’Église et de l’État. Depuis le Moyen Âge, l’anticléricalisme a pu s’estomper, il n’a jamais complètement disparu. Un fil continu court à travers les âges, reliant ses formes successives. Un héritage s’est peu à peu constitué de thèmes, de craintes, d’arguments que les générations se sont transmis, chaque siècle ajoutant à ce fonds commun.Ainsi, au thème médiéval du moine, inspiré des ordres contemplatifs ou mendiants, est venu se superposer au XVIIe siècle celui du jésuite, promis de Pascal à Eugène Sue à une éclatante carrière littéraire. Près de nous, le mythe de l’Opus Dei rajeunit le thème permanent du religieux menaçant l’indépendance de la société. L’histoire de l’anticléricalisme, de son intensité inégale à travers les siècles, de son contenu est ainsi étroitement associée à l’histoire religieuse, politique et intellectuelle des sociétés.Géographie de l’anticléricalismeSi l’anticléricalisme a une histoire, il a aussi une géographie, mais la proposition entraîne des conséquences opposées aux précédentes. Découvrir que l’anticléricalisme a une histoire conduisait à lui conférer une permanence à travers le temps. Constater qu’il a une géographie conduit au contraire à restreindre son universalité dans l’espace. L’examen du vocabulaire et l’étude du phénomène paraissent en effet suggérer que les sociétés ne connaissent pas toutes l’anticléricalisme.Dans quels pays l’anticléricalisme a-t-il trouvé un milieu d’élection? En dehors de la France, où il ne saurait y avoir de doute, l’Italie assurément, l’Espagne et le Portugal, la Belgique, la plupart des pays d’Amérique latine, espagnole et portugaise. Ailleurs, il est moins apparent, ou bien il ne présente plus ce caractère massif qui en fait une réalité sociologique incontestable. Cette énumération dessine un ensemble relativement homogène dont on perçoit aisément les traits communs: ce sont, pour la plupart, des pays de civilisation latine et méditerranéenne. Mais là n’est sans doute pas le caractère déterminant qui motive leur présence dans cette liste. Le facteur décisif est que tous ces pays sont de tradition catholique: le catholicisme romain y a été majoritaire, quand il n’y détenait pas un monopole.Une question surgit aussitôt. N’y a-t-il donc d’anticléricalisme qu’anticatholique? En d’autres termes, s’il est vrai que l’anticléricalisme puise sa raison d’être dans le cléricalisme, le seul cléricalisme serait-il catholique? La réponse de l’expérience paraît bien être positive. Les pays de tradition réformée, en particulier les pays anglo-saxons, ne paraissent pas connaître le phénomène: le mot ne figure dans leur vocabulaire que comme un emprunt étranger. Si quelque chose d’approchant s’y est produit, c’est encore une réaction contre Rome. Ainsi le sentiment antipapiste en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, ou, dans l’Allemagne de Bismarck, le Kulturkampf (combat pour la culture, entendons: pour les lumières de la raison contre l’obscurantisme) furent exclusivement dirigés contre l’Église catholique.L’anticléricalisme est donc une particularité des pays catholiques. Les raisons de cette symbiose apparaissent clairement: le catholicisme a un clergé, une hiérarchie, il repose sur la distinction tranchée entre clercs et fidèles, Église enseignante et Église enseignée. Depuis la Contre-Réforme, il a encore accentué sa constitution autoritaire. Aussi est-ce surtout depuis le XVIe siècle que l’anticléricalisme s’en est pris au catholicisme. Dans le même temps, les sociétés occidentales aspiraient à plus de liberté, elles faisaient de l’individu la mesure et la fin de leur existence. L’anticléricalisme moderne est né de ce contraste entre l’évolution interne de l’Église et celle de la société moderne; ses soubresauts expriment la discordance entre les deux processus.Ainsi replacé dans sa perspective historique, l’anticléricalisme fait songer à d’autres orientations qui se définissent également par la même réaction contre un abus d’autorité et tendent aussi à émanciper l’individu des tutelles que fait peser sur le salarié l’autorité du patron (antipaternalisme), sur la société civile l’autorité militaire (antimilitarisme), sur les peuples dépendants le joug de la puissance coloniale (anticolonialisme). Comparé à ces formes analogues avec lesquelles il entretient des affinités et des correspondances, l’anticléricalisme, que spécifie le cléricalisme, apparaît ainsi comme la manifestation d’un phénomène plus général.Si l’anticléricalisme trouve des terrains d’élection, son implantation présente un relief varié, avec des pôles et des dépressions, tout comme la pratique religieuse, mais la carte de l’anticléricalisme n’est pas exactement le négatif de celle de la fidélité. Sans doute, en Italie, une région comme l’Émilie est à la fois l’une de celles où la pratique tombe aux taux les plus bas et un foyer de l’anticléricalisme; de même, en Belgique, la Wallonie, comparée à la Flandre. Mais les deux cartes ne sont pas toujours aussi nettement complémentaires. En raison de l’interdépendance entre cléricalisme et anticléricalisme, celui-ci est même parfois plus vivace dans les régions de chrétienté traditionnelle où le clergé a conservé prestige et pouvoir. Dans l’ouest de la France, par exemple, qui constitue une survivance de la chrétienté de l’Ancien Régime, l’anticléricalisme est particulièrement virulent. Ainsi se vérifie dans la microgéographie l’interdépendance qui unit à l’échelle du globe cléricalisme et anticléricalisme. Ce n’est pas sur les terres d’indifférence religieuse que l’anticléricalisme prospère.Sociologie de l’anticléricalismeL’anticléricalisme a aussi une sociologie. D’une part, les diverses catégories composant une société ne sont pas également réceptives à ses arguments et, d’autre part, il prend des visages différents selon les milieux. À l’encontre d’une idée aujourd’hui assez répandue, mais qui n’est qu’une généralisation aventureuse, l’anticléricalisme n’appartient en propre à aucune classe; en particulier, il n’est pas l’apanage des classes dites laborieuses. Celles-ci ne l’ont même embrassé qu’après que d’autres leur eurent donné l’exemple.Il y eut ainsi un anticléricalisme aristocratique fait tout ensemble de jalousie entre ordres privilégiés, de mépris pour le clerc et de défiance de l’homme d’épée envers l’homme d’étude.Il y eut ensuite un anticléricalisme bourgeois dont le voltairianisme exprime assez fidèlement l’inspiration et qui a animé le mouvement de sécularisation des sociétés occidentales.Il existe aussi de longue date un anticléricalisme paysan, entretenu par un sentiment tenace contre les droits ecclésiastiques. On constate par exemple que la déchristianisation est généralement plus précoce et plus avancée sur les anciennes terres des abbayes en raison de la confusion entre clergé et propriétaire. Après la Révolution, les prétentions des clercs à recouvrer les biens du clergé mis en vente ont été, en certaines régions, un agent efficace de l’anticléricalisme. La surveillance du repos dominical, une stricte police des mœurs, l’interdiction des bals ont eu leur part dans le développement de l’anticléricalisme (cf. Paul-Louis Courier et sa Pétition pour les villageois qu’on empêche de danser ).Il y a enfin – et c’est dans les sociétés urbaines et industrielles contemporaines le plus important de tous – un anticléricalisme ouvrier. Ses origines sont antérieures à la révolution industrielle: de tout temps, certaines corporations ont été plus défiantes que d’autres à l’égard de l’Église. La naissance de la grande industrie, la formation du prolétariat, la conjonction surtout entre mouvement ouvrier et socialisme ont suscité un anticléricalisme doctrinal, étayé par un système de pensée qui tient la religion pour une illusion et l’Église pour un obstacle sur la voie de la libération.Cette sociologie grossière pourrait être précisée par une sociologie plus attentive au détail: la «vigne» est réputée anticléricale et les vignerons ont dans le monde rural une solide tradition d’anticléricalisme. De même les cordonniers, parmi les artisans. Les enseignants aussi ont droit à une mention particulière: l’Université n’a conquis son indépendance qu’en se soustrayant à la tutelle cléricale et, aujourd’hui encore, la défiance des enseignants à l’endroit de l’Église perpétue le souvenir de leur longue lutte pour l’émancipation. L’histoire éclaire ainsi cette sociologie en en expliquant les anomalies. Elle en montre aussi les changements, car la position d’un groupe n’est pas acquise une fois pour toutes: il y a moins d’un siècle, les médecins passaient tous pour des «esprits forts», et médecine était synonyme de matérialisme; il en va autrement de nos jours. Le cas n’est pas unique.Dans l’ordre idéologique, l’anticléricalisme n’est pas plus homogène. S’il a ordinairement trouvé depuis la Révolution son milieu d’élection à gauche, et ses alliés dans les écoles et les partis qui militent pour une transformation sociale ou politique, l’anticléricalisme n’est pas rare à droite et à l’extrême droite. Le nationalisme suspecte le caractère international de l’Église; il refuse d’incliner la raison d’État et l’indépendance nationale devant les impératifs d’une morale religieuse ou les prescriptions d’une autorité spirituelle. L’anticléricalisme peut donc se combiner avec diverses idéologies.Situation présente et à venirL’anticléricalisme, on l’a vu, est essentiellement une réaction de défense contre la prétention des clercs à régenter la société civile. Cette réaction s’est amplifiée avec la Contre-Réforme et l’ultramontanisme. Si la cause disparaissait, qu’adviendrait-il de l’effet? En d’autres termes, si le catholicisme renonçait à toute prétention à la domination des esprits, l’anticléricalisme ne serait-il pas condamné à dépérir? Or l’Église assemblée en concile a solennellement répudié en 1965 le cléricalisme comme contraire à son esprit: la Déclaration sur la liberté religieuse peut d’une certaine manière être tenue pour une victoire indirecte de l’anticléricalisme. Son objectif atteint, ne devrait-il pas s’effacer? Au reste, le déclin qui semble définir sa situation présente n’annonce-t-il pas sa disparition proche?Pareille éventualité, si elle a la logique pour elle, n’est pas pour autant assurée de s’accomplir. D’abord le déclin présent ne signifie rien: l’histoire de l’anticléricalisme est tout entière faite de ces déclins que suivent de brusques réveils. D’autre part, la doctrine conciliaire sur la liberté religieuse n’est pas encore partout passée dans les faits: l’anticléricalisme garde des raisons de rester mobilisé. Surtout, il convient de se souvenir que la notion de cléricalisme n’est pas totalement objectivable. À côté de critères positifs, aisément vérifiables, elle inclut une part de subjectivité. Enfin, l’anticléricalisme comporte un élément irréductible et qui est une défiance, peut-être une aversion insurmontable pour toute Église. Si peu clérical que le fait religieux puisse devenir, il gardera toujours de quoi irriter, inquiéter ou susciter l’anticléricalisme. Il y a donc lieu de considérer que l’anticléricalisme constitue un facteur durable du champ des idéologies.
anticléricalisme [ ɑ̃tiklerikalism ] n. m.• 1869; de anticlérical♦ Attitude, politique anticléricale.
● anticléricalisme nom masculin Ensemble d'idées, d'attitudes ou de tendances par lesquelles se marque l'hostilité au clergé ou tout au moins à son intervention dans le domaine temporel. ● anticléricalisme (citations) nom masculin Remy de Gourmont Bazoches-au-Houlme, Orne, 1858-Paris 1915 Il y a des anticléricaux qui sont vraiment des chrétiens un peu excessifs. Promenades philosophiques Mercure de France Julien Green Paris 1900-Paris 1998 Académie française, 1971 L'anticléricalisme et l'incroyance ont leurs bigots tout comme l'orthodoxie. Journal Plon Léon Gambetta Cahors 1838-Ville-d'Avray 1882 L'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation. Commentaire Prononcée dans les couloirs de la Chambre des députés, cette phrase visait la situation faite aux religieux dans les colonies françaises. Léon Gambetta Cahors 1838-Ville-d'Avray 1882 Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Discours à la Chambre des députés, 1877 Commentaire Le mot était repris du sénateur Alphonse Peyrat (1812-1891), comme le déclarait Gambetta dans le même discours.anticléricalismen. m. Attitude politique anticléricale.⇒ANTICLÉRICALISME, subst. masc.Attitude ou doctrine des anticléricaux :• 1. Il croyait avec certitude à l'infaillibilité de la raison, au progrès illimité, — quo non ascendam? — à l'avènement prochain du bonheur sur la terre, à la science omnipotente, à l'humanité-Dieu, et à la France, fille aînée de l'humanité. Il avait un anticléricalisme enthousiaste et crédule qui traitait toute religion, — surtout le catholicisme, — d'obscurantisme, et voyait dans le prêtre l'ennemi-né de la lumière.R. ROLLAND, Jean-Christophe, Dans la maison, 1909, p. 967.• 2. Nous sommes en mesure d'en finir avec cet esprit de tracasserie qui a empoisonné la vie française pendant des années. Si un parti catholique veut le faire seul, il aura une minorité de représentants et ne pourra rien du tout.La fin des querelles religieuses, la fin de l'esprit sectaire et de l'anticléricalisme.La loi de séparation n'a pas empêché l'Église catholique d'exister en France.BARRÈS, Mes cahiers, t. 12, 1919-20, p. 191.• 3. La voix sèche de Meynestrel s'éleva de nouveau :— « Je pense que ce n'est pas cet anticléricalisme idiot, cher à la bourgeoisie libre penseuse du XIXe siècle, qui libérera les masses du joug des religions. Là encore, le problème est social. Les assises des religions sont sociales. De tout temps, les religions ont puisé leur principale force dans la souffrance de l'homme asservi. Les religions ont toujours profité de la misère. Le jour où ce point d'appui leur manquera, les religions perdront leur vitalité. Sur une humanité plus heureuse, les religions actuelles n'auront plus de prise... »MARTIN DU GARD, Les Thibault, L'Été 1914, 1936, p. 85.Rem. 1re attest. 1907 ds Le Larousse pour tous, Paris, Larousse, t. 1, 1909; repris aussi par Lar. 20e-Lar. Lang. fr., ROB., QUILLET 1965; dér. de anticlérical, suff. -isme.PRONONC. :[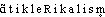 ].STAT. — Fréq. abs. littér. :55.BBG. — AQUIST. 1966. — DUB. Pol. 1962, p. 141. — Foi t. 1 1968.anticléricalisme [ɑ̃tikleʀikalism] n. m.❖♦ Attitude, politique anticléricale. || « Il avait un anticléricalisme enthousiaste et crédule… » → Obscurantisme, cit. 2.0 (…) le ciment qui assurait au bloc radical-socialiste sa cohésion, c'était l'anticléricalisme.F. Mauriac, Bloc-notes 1952-1957, p. 54.❖CONTR. Cléricalisme.
].STAT. — Fréq. abs. littér. :55.BBG. — AQUIST. 1966. — DUB. Pol. 1962, p. 141. — Foi t. 1 1968.anticléricalisme [ɑ̃tikleʀikalism] n. m.❖♦ Attitude, politique anticléricale. || « Il avait un anticléricalisme enthousiaste et crédule… » → Obscurantisme, cit. 2.0 (…) le ciment qui assurait au bloc radical-socialiste sa cohésion, c'était l'anticléricalisme.F. Mauriac, Bloc-notes 1952-1957, p. 54.❖CONTR. Cléricalisme.
Encyclopédie Universelle. 2012.
